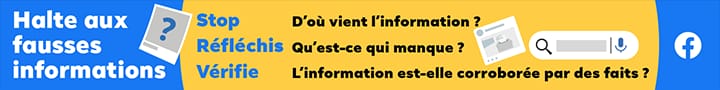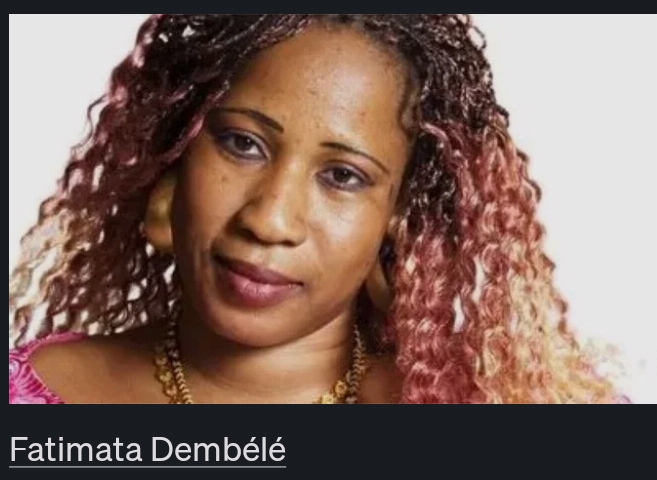Affaire Mahamat Massar Houd : détournement de 6 milliards de F CFA

Justice
Par un point de presse animé le jeudi 30 octobre 2025 à la Maison de la presse du Tchad, l'avocat de l'ancien trésorier payeur d'Abéché, Mahamat Massar Houd, Me.Jatto Aimé dénonce << le secret d’instruction du juge de l’affaire qui est pendante devant le juge d’instruction >>.